On dit souvent que l’homme africain ne cuisine pas.
Avec sa barbe dense, ses bras musclés et sa forte bedaine, mon père s’était en partie défait de ce stéréotype.
Il cuisinait, mais seulement le dimanche.
Les autres jours de la semaine, il ne mettait pas un pied dans la cuisine à part pour essayer d’atteindre le tout petit balcon que nous avions au deuxième étage. C’était un homme costaud, et la petite barrière du balcon, pas très solide, criait secrètement d’anxiété quand il s’appuyait dessus pour donner des ordres aux ouvriers affairés et aux enfants jouant en bas.
Chez moi, on se levait tôt le dimanche. A cette époque, mon père était le plus fervent des catholiques. Il allait à la messe tous les jours de la semaine, celle du dimanche représentant le point culminant de sa piété. Autant mon père appréciait la messe, autant la messe était pour nous, les enfants, un moment affreusement long.
L’appel du Révérend Père marquait le début d’un rituel interminable : se lever, s’agenouiller, s’assoir, se lever, s’assoir, s’agenouiller, s’agenouiller encore et encore. Sans oublier que le support pour s’agenouiller n’était pas matelassé ! Mon petit corps d’enfant de 9 ans était si préoccupé par mes genoux souffrant contre le bois dur à travers mon beau pantalon du dimanche que je n’arrivais jamais pas à faire mes Je Vous Salue Marie correctement.
Souvent, fatigué physiquement par cette gym liturgique, mes frères et sœurs et moi-même nous affalions sur les sièges en bois en espérant trouver une position confortable. Mon père nous foudroyait alors d’un regard des plus glacials qui nous transperçait jusqu’à la colonne vertébrale. Des fois, il se montrait plus tolérant, laissant à un chanceux le droit de s’endormir entre mes parents, emmailloté entre l’épaule dodue de ma mère et le bras rigide de mon père légèrement parfumé à l’eau de Cologne.
A chaque service, ma mère glissait de l’argent dans nos mains pour en faire don à l’Eglise, et, aussi sûrement que le soleil ardent brillait par la volonté de Dieu, nous partagions la somme en deux : une petite part pour le trio saint Jésus, Marie et Dieu, une plus grande part mise de côté pour de petits péchés.
Nous quittions discrètement l’église en prétextant d’une envie pressante, rejoignant ainsi la rue animée, en dehors de l’enceinte de la cathédrale, où nous achetions furtivement du yaourt glacé.
Comme il est dit dans la Bible, « les eaux dérobées sont plus douces, et le pain mangé en secret est savoureux. » C’était le meilleur yaourt glacé que nous ayons mangé. Il méritait de risquer les flammes éternelles de l’enfer.
Ce trésor était vendu dans une boîte pyramidale qui semblait taillée tout juste pour ma toute petite main d’enfant. Elle tenait si bien dans ma main que j’étais convaincu que Dieu avait conçu mes mains juste pour cet instant. La vendeuse semblait deviner notre crime mais elle m’adressait toujours un sourire quand elle taillait la pointe de la pyramide à la lame pour pouvoir sucer la glace à l’acidité savamment dosée.
Je n’avais que peu de temps pour savourer ce met, craignant que mon absence prolongée n’éveille la suspicion de ma famille. Je finissais toujours par ouvrir l’emballage, mettre tous les petits morceaux de glace dans ma bouche, les réduire en minuscule flocons en les croquant, et courir pour rentrer dans l’église. Je revenais auprès de mes parents, ma bouche se contractant toujours instinctivement en réaction à l’acidité de la glace. Mon père me regardait alors d’un air suspicieux, mais ne me faisait jamais de remarque.
*******
Après la messe du dimanche, mon père allait dans la cuisine pour un tout autre genre de service. Le dimanche était un jour spécial pour moi parce que c’était le seul jour où nous ne mangions pas de plat traditionnel nigérian à la maison.
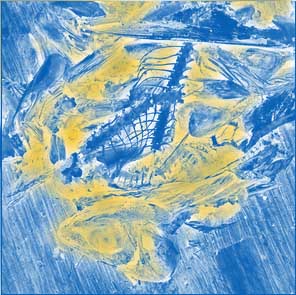 |
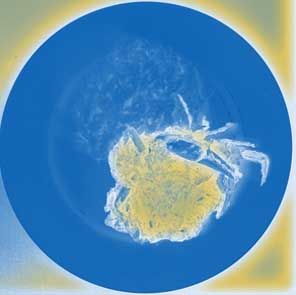 |
Le repas que préparait mon père les dimanches était légendaire, des recettes recherchées qui pouvaient demander 3 voire 4 heures de préparation.
Quand il finissait de préparer à manger, l’après-midi était toujours bien entamée. Je me retrouvais comme un petit africain mourant intérieurement de faim, assis à l’entrée de la cuisine, les yeux dans le vide, le ventre ballonné, des mouches bien trop enthousiastes s’affairant autour de moi. C’est des années plus tard, après m’être installé aux Etats-Unis, je me suis rendu compte que mon père était en fait fan du brunch du dimanche.
Dans la cuisine, mon père avait l’esprit en ébullition. Son air sombre laissait place aux sifflements et aux chants. L’homme musclé laissait alors place à un cheval fougueux et agile : le pied léger, pivotant entre les feux de la cuisinière et le plan de travail, faisant des pirouettes et des pliés, le tout en cassant des œufs, décollant des aliments caramélisés au fond d’une poêle en la remuant et éminçant le monde entier.
Quand la table était enfin prête pour 6 (deux parents et quatre enfants), il y avait vingt plateaux, remplis, la nourriture vacillant ou roulant avec les mouvements des plateaux. Viandes et légumes sautées, pile de sandwichs et salade colorée. Des œufs sous toutes leurs formes, conventionnelles ou plus travaillées. Des haricots mijotés, bouillis ou rissolés. Des grosses tranches de bacon ou de fines tranches de dinde. Des saucisses sorties de leur emballage, natures, bien rebondies et luisantes.
Il y avait aussi des choses que je n’avais jamais vues et que je ne reverrai probablement jamais. Mon père était créatif : il transformait des aliments communs, les déstructurant pour leur donner ensuite un aspect, un goût ou une texture différente.

Quand le brunch était fini, tout le monde avait le ventre si rempli que personne ne bougeait plus jusqu’au lundi.
*******
J’étais un enfant gâté. Quand je décidais quelque chose, je me montrais alors, comme le disait ma mère, « aussi têtu qu’une chèvre ».
Cela nous amène à ce moment où, à 9 ans, je me suis lassé des plats traditionnels et, à la plus grande confusion de mes parents, j’ai lancé une pétition pour avoir les plats du dimanche tous les autres jours de la semaine. Après toute une vie de nourriture traditionnelle, je sentais qu’il était temps que la famille prenne une nouvelle direction.
Mon décret :
|
• Tout aliment traditionnel dans l’enceinte de notre maison sera désormais considéré comme produit de contrebande. • Une cessation immédiate de tout arôme et saveur indigène piquante ! • Oignons émincés et tomates mijotées sont désormais bannis des marmites. • Poisson fumé, séché, crustacé…Tout ce qui est assimilé à du poisson est interdit. • Les gari (manioc séché) doit être éliminé. • La maison ne devra plus jamais subir l’odeur de l’huile de palme sur le feu. • Plus de gombos émincés, ni de tiges empilées dans de l’eau, signe de déconvenue chlorophyllienne. • Les ignames marrons, dont le goût est similaire à leur odeur, insipide et gluant, c’est fini ! |
J’ai présenté ces demandes auprès de mes parents. Ils les ont ignorés.
“ Ah ! Tu veux de la nourriture oyinbo ? Tchiiiip.”
|
|
Il avait alors été décidé qu’on ne me servirait plus que du riz blanc, des bananes plantains et de la tome mijotée. C’est un compromis que j’ai fièrement accepté… jusqu’à ce que je commence à envier mes frères et sœurs. Mes lèvres ne connaissaient plus la sensation de l’huile les enrobant, ni la satisfaction que celle-ci provoque après manger. Je faisais semblant d’être ravi de ma nourriture « moins africaines » en les regardant déguster des soupes savoureuses et parfumées.
- Afang: une sauce feuilles épicée, à base de légumes verts au goût particulier, ornée de crabes farcis aux œufs de poissons ;
- Ogbono: plein de saveur (ça vous nourrit l’âme) et visqueux, cela ressemble beaucoup à l’umami pour les papilles ;
- Owo: une rare délicatesse, quasiment introuvable. Les rares fois que nous avons pu en avoir de parents en visite de régions lointaines. Jaune, plutôt épais que fin, avec une consistance appétissante. Un plat bien pensé accompagné d’une myriade de poissons d’eau douce cuits à la vapeur et de bigorneau…
*******
Tout s’est arrêté le soir où mon père est revenu à la maison avec un sac en toile noir. Il y a plongé son bras et en a sorti deux choses.
La première était une petite boule d’amala parfaitement ronde, toujours fumante, enroulée dans un film alimentaire perlant à cause de la chaleur. Elle était d’un marron très foncé, presque noir, à l’aspect brillant, plus lisse qu’un galet, à peu près de la taille de mon petit ventre affamé.
La deuxième chose qu’il sorti du sac était une soupe dans un bol lui aussi couvert de fil alimentaire. Elle était d’un jaune orangé surprenant, d’une consistance crémeuse et lisse. Des petits morceaux de différentes viandes s’y prélassaient ostensiblement. Pour décorer la soupe, il y avait, d’un côté, un peu de poivron rouge mijoté, de l’autre, un coulis vert. Une délicieuse huile de piment rouge entourait l’emplacement de ce trio de ces visqueuses victuailles.
Du noir, du rouge, du vert, du jaune… Un rêve multicolore captivait mon regard. Les senteurs enivrantes transportées par les vapeurs de ces mets s’immisçaient dans mes narines. Mes jambes faiblirent légèrement à la vue de cette magnifique viande, pendant que mon estomac exprimait clairement son excitation. J’ai regardé mon père, clignant des yeux et calme. Il me regarda et on sut alors que ma grève était finie.

« On appelle ça du Gbegiri. Ils le préparent avec des haricots. » m’expliqua-t-il une fois qu’on avait fini de manger. Mes lèvres se remettaient à peine de la chaleur du plat, un détail que je n’avais pas relevé. Nous sommes restés assis là, mon père et moi, chacun le pantalon déboutonné, affalés sur le canapé. J’avais le ventre complètement rempli. C’était lundi.
*******
L’amala accompagné de gbegiri, d’ewedu et de ragoût était au menu des deux premiers dîners de la série de diner-débat sur la question noire aux Etats-Unis (http://www.fromlagos.com/ )… Mais écosser ces haricots, quelle plaie !
Traduction : Réana Kebe
|
|
Le site de Tunde : |
|
Sur OkayAfrica, ça donne ça :
|
|



